Introduction
Définition
Etymologiquement, «luxe» vient du latin «lux» qui signifie lumière, goût, éclairage, élégance mais aussi de «luxuria» : l’excès, le clinquant, la luxure. Le luxe balance donc toujours entre les deux pôles du paraître et de l’être.
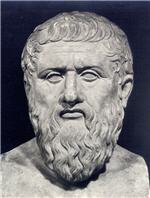 Platon
Platon
Le luxe est l’incarnation du goût, du raffinement, de la tradition, de l’héritage, de l’excellence, du savoir-faire mais aussi du superflu, de l’ostentation et de la différenciation sociale. L’économiste Jean-Baptiste SAY le définissait comme « l’usage des choses coûteuses ». La notion de luxe est critiquée par les penseurs antiques (Platon) et par la pensée moraliste qui considère la quête de possession d’objets précieux comme une cause de l’affaiblissement de la vertu (Fénelon, Rousseau ou Montesquieu). S’inscrivant dans un courant de la pensée chrétienne, ces humanistes critiquent les instincts égoïstes, l’oisiveté et l’absolue vanité engendrés par les fastes du luxe.
Depuis le début du XXème siècle, il présente à certains égards un autre aspect, celui du strass et des paillettes au risque de faire oublier ses codes ancestraux.
Difficile à délimiter, le champ du luxe est plus vaste qu’il n’y paraît. Une étude réalisée par le cabinet Mac Kinsey en 1990, identifiait 35 secteurs d’activité « susceptibles de comporter des marques de luxe ». Ces secteurs appartiennent à quelques domaines, dont la personne, englobant à la fois l’habillement, les accessoires de mode, les chaussures, les parfums et cosmétiques, la maroquinerie ; la maison, qui englobe les arts de la table, de l’ameublement, des luminaires ; les sorties, voyages et fêtes qui englobent l’hôtellerie, la restauration, les véhicules mais aussi les vins et spiritueux.
Produits du luxe français
Histoire
Au niveau historique, le luxe est issu d’une longue tradition et porte, en lui, l’héritage du passé. L’essentiel est de se concentrer sur l’émergence du luxe « moderne ». Il ne paraît pas nécessaire de revenir sur ses premières expressions sous l’Antiquité ou au Moyen-Age. C’est à la fin du XVIIe siècle qu’apparaît un nouvel art du paraître préfigurant le système actuel. C’est la naissance de ce que l’on désigne comme « l’art de vivre » et Paris tient une place de premier ordre. La Cour de Louis XIV installe un faste jamais connu auparavant qui rayonne dans le monde entier. « Il faut éblouir pour s’imposer ». Les fournisseurs de ces biens précieux ouvrent boutique et les premières revues de « mode » sont publiées. Face à l’avance anglaise ou germanique dans certaines industries, le ministre Colbert souhaite dynamiser l’économie et les exportations françaises avec la création des manufactures (les Gobelins, la Manufacture des Glaces qui seront suivies de Sèvres, la Savonnerie,...).
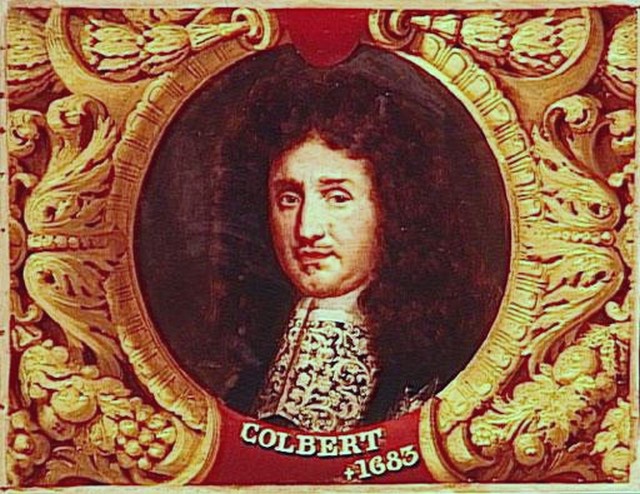
A cette mode de Cour extravagante, dont l’objectif est de démontrer la suprématie aristocratique, vient s’ajouter des habitudes plus sobres et pratiques dans les villes. Cette attitude est adoptée par la classe bourgeoise qui, par la même, se distingue et se constitue une identité de groupe. Le luxe fait l’objet de vifs débats dans ce siècle des Lumières : nécessité ou futilité ? C’est la fameuse « querelle du luxe » qui voit s’affronter Rousseau et Voltaire.
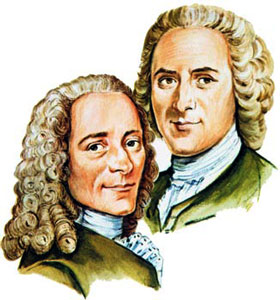 Rousseau & Voltaire
Rousseau & Voltaire
Ainsi l’ambitieuse politique colbertiste a conduit à un accroissement fort et rapide des manufactures d’exception, qui s’installent peu à peu dans Paris tels que le fourreur Revillon, le verrier Baccarat, l’horloger Breguet ou encore Nitot (qui réalisa les bijoux du sacre de Napoléon Ier, voir la parure ci-dessous).
Tout au long du XVIIIe siècle, l’essor de la demande de produits précieux conduit à l’épanouissement d’un artisanat et de métiers d’arts, à Paris notamment: joailliers, horlogers, orfèvres, coiffeurs, marchands de tissus et autres commerces « de luxe » ouvrent dans Paris. Tous les métiers sont sollicités pour les grandes tenues d’apparat de la cour et l’Europe entière suit l’évolution des modes de la cour de Versailles à travers des gazettes et des gravures qui préfigurent les revues de mode. Des gravures satiriques circulent également et critiquent ces excès. Les fournisseurs, recherchés pour leurs produits rares, gagnent de plus en plus d’influence auprès de leur clientèle. Certains maitres se font un nom. Le début des révolutions techniques contribue largement, par ailleurs, au développement de ces savoir-faire.
 Parure napoléonienne
Parure napoléonienne
Après 1789, le secteur, composé alors essentiellement de petits ateliers, continue à prospérer. De nouvelles maisons s’établissent, surtout, à partir du milieu du XIXe siècle. L’art de vivre urbain et bourgeois se fonde sur le renouvellement de l’art de vivre aristocratique avec des produits nouveaux adaptés à l’évolution des modes de vie.
A la fin du XIXe siècle, deux changements majeurs interviennent avec la haute couture. D’abord, le couturier devient un créateur avec un nom reconnu, du prestige, une indépendance par rapport à la cliente. La haute couture apparaît comme un composé de création artistique et d’industrie (la série limitée). Puis s’impose un demi-luxe, plus accessible, dont les grands magasins vont devenir la vitrine.
Les Grands Magasins
Au cours de son histoire, le luxe a été alternativement condamné, assimilé aux pires turpitudes, puis exalté comme le fruit des capacités créatrices de la nation et secteur pourvoyeur d’emplois.
Faut-il voir le secteur du luxe comme un domaine ne profitant qu'à des privilégiés affichant par un comportement ostentatoire leurs dépenses superflues, ou comme un secteur participant au développement économique de notre pays ainsi qu'à son image ?
Cette problématique sera abordée en présentant tout d’abord les critiques du luxe les plus répandues, puis en analysant les apports du luxe à notre pays en mettant l’accent sur ses contributions à l’économie française contemporaine.
Enfin une présentation de l'histoire et des retombées du secteur du luxe sur la ville de Cannes, ville connue pour ses nombreuses vitrines de luxe et ses hôtels 5 étoiles, enrichira le sujet étudié.
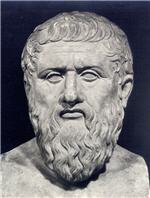
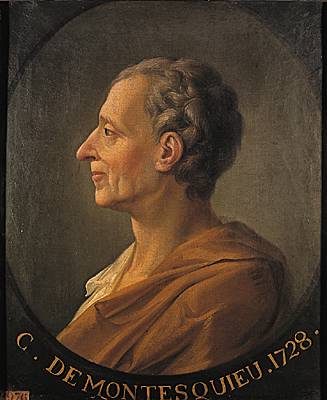
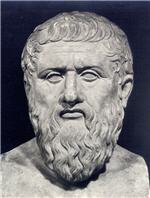
Définition du Luxe
Histoire du Luxe
Problématique




